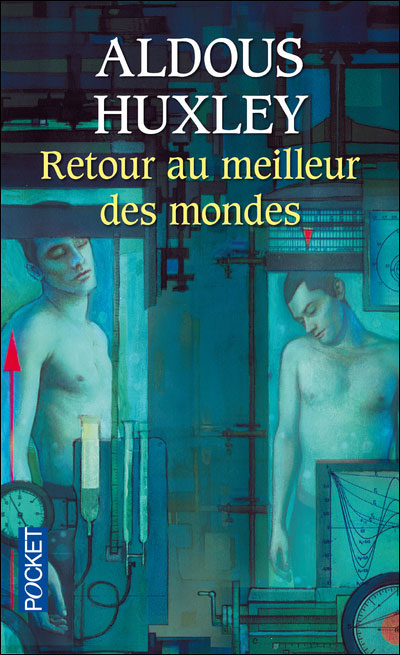Je propose de suggérer vos lectures ici.
Une bonne introduction à la philosophie, qui reste concentré sur l'essence de la philosophie et de sa démarche, en commençant par les présocratiques.

Uploaded with ImageShack.us





Dans la ligne de ses précédents ouvrages sur l’univers, les origines de celui-ci, … Stephen HAWKING, le très célèbre astrophysicien anglais, nous offre ses dernières réflexions de manière toujours aussi pédagogique.
Au-delà d’être un théoricien connu et reconnu, Stephen HAWKING fut l’un des premiers grands vulgarisateurs sur des sujets qui ne sont vraiment pas faciles d’accès.
Mais d’une part, le jeu en vaut la chandelle quand cela est fait avec autant de talent, et d’autre part, à quoi serviraient la recherche et la progression des connaissances qui en découle si cela ne se traduisait par de vrais efforts d’information pédagogique auprès du grand public ?
Pourquoi et comment l’Univers a-t-il commencé ?
Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?
Quelle est la nature de la réalité ?
Comment expliquer que les lois naturelles soient
aussi finement ajustées ?
Et nous, pourquoi donc existons-nous ?
Longtemps réservées aux philosophes et aux théologiens, ces interrogations relèvent désormais aussi de la science.
C’est ce que montrent ici avec brio et simplicité Stephen Hawking et Leonard Mlodinow, s’appuyant sur les découvertes et les théories les plus récentes, qui ébranlent nos croyances les plus anciennes.
Pour eux, inutile d’imaginer un plan, un dessein, un créateur derrière la nature. La science explique bel et bien à elle seule les mystères de l’Univers.
Des réponses nouvelles aux questions les plus élémentaires : lumineux et provocateur !
Le premier ouvrage important de Stephen Hawking depuis dix ans.

Le cinéma n'existe peut-être que sous la forme d'un système d'écarts entre des choses qui portent le même nom sans être membres d'un même corps. C'est le lieu matériel où l'on s'émeut au spectacle des ombres. C'est aussi le nom d'un art constitué comme tel par la passion cinéphilique qui a brouillé les frontières de l'art et du divertissement. Ce fut, un temps, l'utopie d'une écriture du mouvement, unissant le travail, l'art et la vie collective. C'est parfois encore le rêve toujours déçu d'une langue des images.
Jacques Rancière étudie quelques formes exemplaires de ces écarts : le cinéma prend à la littérature ses fictions en effaçant ses images et sa philosophie. Il rejette le théâtre au prix d'en accomplir le rêve. Il règle le passage de l'émotion des histoires au pur plaisir de la performance ou alourdit les corps pour nous montrer la pensée à l'oeuvre. Il expose en même temps la capacité politique de tous et son propre pouvoir d'en transformer les manifestations en feux d'artifice ou en formes qui se dissipent comme des cercles à la surface de l'eau.