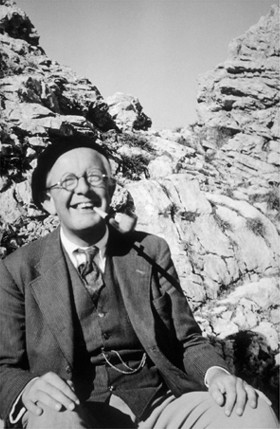Comment se forme notre intelligence ?
Comment l’humain apprend-il ?
Quel rapport se joue entre les sciences théoriques et notre logique interne, biologique ?
Comme ses découvertes restent d’une impressionnante actualité et que je constate chaque jour la validité de ses hypothèses, je vais essayer de vous en donner un aperçu...
De quelle intelligence parlons-nous ici ?
Ce mot peut recouvrir de nombreuses réalités. Nous la définirons ici comme l’ensemble, en perpétuelle évolution, de nos capacités à comprendre, concevoir et nous adapter au monde réel – entre autres, notre capacité à résoudre des problèmes quels qu’ils soient.
Un point capital : il existe bien sûr d’importantes variations d'un individu à l'autre. Piaget s’est focalisé sur les structures de pensée et mécanismes communs à tous, ce qui faisait déjà assez de boulot… !!!
Ce qui est génial, c’est qu’il a effectivement dégagé des mécanismes communs, présents dès les premières heures de vie et à tout âge, mais qu’en plus il a montré la construction progressive de structures de pensée spécifiques, de plus en plus complexes, suivant un ordre toujours identique, et passant par des étapes obligées.
Pour aujourd'hui je vais vous parler de ces mécanismes généraux d'évolution des connaissances, puis plus tard des grandes structures de pensée et de leurs stades successifs de développement, de la naissance à l'âge adulte.
De l’action naît la pensée.
Tout commence par l’action.
L’intelligence ne naît pas de l’observation, mais de l’action du sujet sur son milieu, ou plutôt de son interaction avec le milieu : je fais ça, il se passe ça. C’est dans cette interaction que la pensée se construit, et que nous nous adaptons progressivement au monde.
Il nous faut alors définir un concept central, celui de schème (ou schème d'action).
Lorsqu’une action est volontaire, qu'elle est répétée dans différents contextes, on peut considérer la trame de cette action comme une entité à part entière : on va alors parler de schème .
L’action est ce qu’on observe, le schème c’est l’abstraction des caractéristiques spécifique de cette action. Lorsqu’on réalise une action de manière intentionnelle, c’est qu’on possède le schème de cette action : elle est intériorisée. Le schème recouvre à la fois ce qui se passe dans notre organisme lors de la réalisation de l’action mais aussi un ensemble de savoirs et de savoir-faire, une dimension motivationnelle et affective…
En d’autres termes, dès que le bébé a dépassé le stade des réflexes et donc des actions fortuites, dès qu’il répète une action sur différents objets ou dans différentes situations, on peut commencer à parler de schème : schème de préhension, schème de succion... Nous pouvons donc considérer que le bébé pense (il intériorise des actions), même si cette pensée n’est pas faite de mots et reste directement subordonnée à la situation immédiate.
Toute pensée, toute construction abstraite de notre conscience découle au départ de schèmes concrets que nous avons expérimentés, puis complexifiés.
Si je suis aujourd’hui capable de mettre des concepts en relation, c’est qu’il y a très longtemps j’ai commencé par mettre en relation des objets concrets - par exemple : ce doudou DANS cette boîte, ce cube SUR celui-là.
Penser, c’est aussi agir, transformer notre réel. Nous pouvons agir soit dans la réalité, grâce à nos schèmes moteurs ; soit par la pensée, grâce à des schèmes abstraits découlant des premiers.
Nous nous servons de schèmes toute la journée, certains assez simples (marcher, ouvrir une porte, s’asseoir, se brosser les cheveux…), d’autres qui sont de véritables systèmes coordonnant d’autres schèmes préexistants (conduire une voiture, réaliser une recette…). Certains encore sont totalement abstraits (reconnaître quelque chose, c’est-à-dire le classer selon ses caractéristiques ; opposer deux idées, organiser son programme de la journée…).
Les schèmes évoluent de la naissance à l’âge adulte grâce à notre exploration, notre expérimentation sur le réel. Progressivement, ils s’organisent, se coordonnent, en systèmes de schèmes correspondant à une situation, puis en systèmes plus généraux (applicables à des situations de plus en plus nombreuses) qu’on appellera structures de pensée (on verra ça plus tard...).
Alors comment évoluent-ils ?
[
Les mécanismes généraux de l’équilibration : l'adaptation intelligente
Si notre intelligence se construit, s’enrichit progressivement, c’est parce qu’elle tend à nous ramener à un équilibre satisfaisant lorsqu’un problème se présente (c’est un mécanisme qui est en fait inhérent à tout organisme vivant).
--> Je suis à un certain niveau de connaissance (ou de capacités). Jusqu’à présent, les situations rencontrées sont cohérentes avec mes connaissances déjà construites, mes capacités me permettent de résoudre les problèmes rencontrés de façon satisfaisante pour moi. On appelle cela l’assimilation : j’assimile le réel aux schèmes que j’ai déjà construits. On est donc dans une situation d'équilibre entre le monde et moi.
30
Exemple chez le tout petit qui veut déplacer des objets d’un endroit à l’autre : il a auparavant construit le schème "transporter" = tenir un objet dans sa main fermée tout en marchant (coordination de deux schèmes simples). Il peut l’appliquer à chacun de ses duplos pour les emporter à l’autre bout du salon : il assimile les duplos à son schème « transporter ».
--> Seulement, tout à coup, surgit un problème ou une situation que je ne peux assimiler à mes schèmes habituels : une donnée qui rentre en contradiction avec mes connaissances actuelles ou un problème que je ne peux résoudre par mes moyens habituels.
Il y a donc déséquilibre : mes structures internes ne sont plus adaptées à la situation présente. Il faut revenir à un équilibre stable, et pour cela modifier mon comportement : c'est l'accommodation.
C’est là que tout se joue :
- soit mon accommodation échoue et je reviens au niveau d’équilibre précédent, c’est-à-dire que je vais laisser tomber cette situation trop complexe qui me met dans un état d’inconfort que je ne parviens pas à résoudre ;
- soit je parviens à adapter mes structures, et à passer à un niveau supérieur d’équilibre. J’accommode soit en utilisant un autre schème déjà construit (que je n'aurais pas forcément utilisé dans cette situation), soit en enrichissant mon schème par une variante, soit en remaniant totalement mon schème pour parvenir à une structure plus élaborée.
L'accommodation existe à tous les stades de la vie, sous des formes plus ou moins complexes, et c’est elle le moteur de la construction de nos connaissances !
L'accommodation, c'est le "et si nous faisions autrement?", ce qui peut aussi bien consister à modifier une action, qu'à voir les choses sous un nouvel angle, tout simplement parce que l'ancienne manière arrive à une limite.
--> Seulement, tout à coup, surgit un problème ou une situation que je ne peux assimiler à mes schèmes habituels : une donnée qui rentre en contradiction avec mes connaissances actuelles ou un problème que je ne peux résoudre par mes moyens habituels.
Il y a donc déséquilibre : mes structures internes ne sont plus adaptées à la situation présente. Il faut revenir à un équilibre stable, et pour cela modifier mon comportement : c'est l'accommodation.
C’est là que tout se joue :
- soit mon accommodation échoue et je reviens au niveau d’équilibre précédent, c’est-à-dire que je vais laisser tomber cette situation trop complexe qui me met dans un état d’inconfort que je ne parviens pas à résoudre ;
- soit je parviens à adapter mes structures, et à passer à un niveau supérieur d’équilibre. J’accommode soit en utilisant un autre schème déjà construit (que je n'aurais pas forcément utilisé dans cette situation), soit en enrichissant mon schème par une variante, soit en remaniant totalement mon schème pour parvenir à une structure plus élaborée.
L'accommodation existe à tous les stades de la vie, sous des formes plus ou moins complexes, et c’est elle le moteur de la construction de nos connaissances !
L'accommodation, c'est le "et si nous faisions autrement?", ce qui peut aussi bien consister à modifier une action, qu'à voir les choses sous un nouvel angle, tout simplement parce que l'ancienne manière arrive à une limite.
30
Exemple d’accommodation chez le gamin aux duplos : après les duplos, il veut aussi transporter la caisse qui les contenait. Ici le schème de transport qui consistait à prendre dans la main ne fonctionne plus. Par tâtonnements plus ou moins longs et laborieux (accommodation) il va peut-être réussir à adapter son schème et trouver une nouvelle variante, découlant d'un autre schème, qui consistera à soulever l’objet à pleins bras. Au fur et à mesure de l’expérimentation de ses schèmes de transport, l’enfant va déduire que la première variante convient aux petits objets, tandis que la seconde convient aux plus gros etc. et l’assimilation sera quasiment immédiate.
Ce processus d'équilibration est très facilement reconnaissable chez les enfants petits (jusqu'à 2 ans), mais il entre en jeu à tout âge dès que le réel résiste à notre action ou notre compréhension immédiates - simplement nos accommodations adultes sont un peu plus complexes, et surtout plus abstraites.
 Je ne sais pas si c'est très clair... Je vous propose d'observer comment vous réagissez, ce qui se passe dans votre tête, face à un problème banal qui se présente (ou d'observer vos enfants !), ce qui nous permettrait de nous appuyer sur des exemples...
Je ne sais pas si c'est très clair... Je vous propose d'observer comment vous réagissez, ce qui se passe dans votre tête, face à un problème banal qui se présente (ou d'observer vos enfants !), ce qui nous permettrait de nous appuyer sur des exemples...
Ce processus d'équilibration est très facilement reconnaissable chez les enfants petits (jusqu'à 2 ans), mais il entre en jeu à tout âge dès que le réel résiste à notre action ou notre compréhension immédiates - simplement nos accommodations adultes sont un peu plus complexes, et surtout plus abstraites.